Relations algéro-françaises : deux siècles plus tard, le bourreau joue la victime
Une contribution du Dr A. Boumezrag – Deux siècles. Deux cents ans depuis qu’un certain 1830 vit la France débarquer en Algérie avec la fallacieuse intention de civiliser des peuples qui ne lui avaient rien demandé. Deux siècles depuis qu’un empire, drapé dans les idéaux des Lumières, imposa à coups de fusils et d’enfumades une mission qui relevait davantage du pillage que de l’éducation. Deux siècles plus tard, pourtant, voilà que le bourreau pleurniche, geint et réclame justice. Ah, l’ironie de l’histoire !
L’amnésie sélective et le retour du révisionnisme
Aujourd’hui, la France postcoloniale se sent agressée. Elle crie au «masochisme mémoriel» à la moindre tentative d’introspection, elle gémit face aux exigences d’excuses, elle accuse l’Algérie d’entretenir une rancune stérile. Pire encore, certains osent inverser les rôles : «Nous, victimes du wokisme ! Nous, cibles de la cancel culture ! Nous, persécutés par une repentance sans fin !» Pauvre France, martyrisée par les fantômes de son passé !
Ce réflexe de victimisation ne date pas d’hier. Dès les années 1960, au lendemain de l’indépendance algérienne, la nostalgie de l’Algérie française a nourri un discours de déni. Des figures comme Jean-Marie Le Pen, ancien tortionnaire en Algérie, aux cercles intellectuels révisionnistes, la rengaine est la même : nier, minimiser, relativiser. L’ouvrage d’Yves Courrière sur la guerre d’Algérie, ou encore les prises de position d’historiens comme Bernard Lugan, illustrent ce refus obstiné de regarder l’histoire en face.
Entre justification et travestissement
Le discours dominant, jadis triomphaliste, oscille aujourd’hui entre l’amnésie sélective et la posture victimaire. On nous dit que «ce n’était pas si simple», que «les bienfaits de la colonisation» mériteraient d’être soulignés, que les méchants indépendantistes n’ont rien fait de mieux une fois le pays repris en main. Ah, cette douce tentation du relativisme historique, cet art de noyer les atrocités dans le flou commode du «contexte de l’époque» !
C’est ainsi que l’on voit ressurgir les discours sur la «mission civilisatrice» de la France, recyclés dans les discours politiques contemporains. Nicolas Sarkozy, en 2007, parlait d’une colonisation qui n’avait pas eu que des effets négatifs. Plus récemment, Emmanuel Macron, tout en qualifiant la colonisation de «crime contre l’humanité», a fini par adopter un langage plus tiède, évitant soigneusement toute excuse officielle.
Un passé qui ne passe pas
Mais soyons clairs : la colonisation ne fut pas un malentendu, une maladresse diplomatique ou un échange de bons procédés. Elle fut une domination brutale, une entreprise de destruction identitaire et d’exploitation systématique. Les enfumades des grottes du Dahra en 1845, orchestrées par le général Cavaignac, les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en 1945, les camps de regroupement durant la guerre d’Algérie, tout cela relève d’une logique de terreur et de soumission. Que cela dérange, fatigue ou indispose, les faits sont là.
Aujourd’hui encore, l’héritage colonial pèse lourdement sur les consciences et les inégalités. Les discriminations systémiques à l’embauche, les violences policières, le mépris institutionnel à l’égard des populations issues de l’immigration postcoloniale en témoignent. La France peine à faire face à son passé, et chaque tentative d’introspection se heurte à des crispations identitaires exacerbées.
Une comédie cynique
Alors, quand la France adopte la posture du martyr, quand elle feint l’incompréhension face aux exigences de reconnaissance, elle ne fait que rejouer, avec un cynisme consommé, l’une de ses vieilles comédies : celle où le bourreau finit toujours par se poser en victime. Mais l’histoire, elle, n’est pas un vaudeville. Et la vérité, tôt ou tard, finit toujours par frapper à la porte. Reste à savoir si la France osera enfin lui ouvrir.
Une réconciliation sincère est-elle possible ?
Si la France souhaite réellement tourner la page de son passé colonial, elle ne pourra se contenter d’un simple récit atténué ou d’un refus catégorique de toute responsabilité. Reconnaître la vérité historique ne signifie pas s’auto-flageller, mais permettre un dialogue honnête avec les anciennes colonies et leurs descendants. Ce n’est qu’en acceptant pleinement les ombres de son passé que la France pourra construire un avenir où mémoire et justice ne s’opposent pas, mais s’unissent enfin pour une réconciliation sincère et durable.
Le passé ne se change pas, mais il éclaire le chemin du futur. Seule la vérité, assumée avec courage, peut ouvrir la voie à une fraternité véritable, fondée sur le respect, la dignité et la justice pour tous.
A. B.











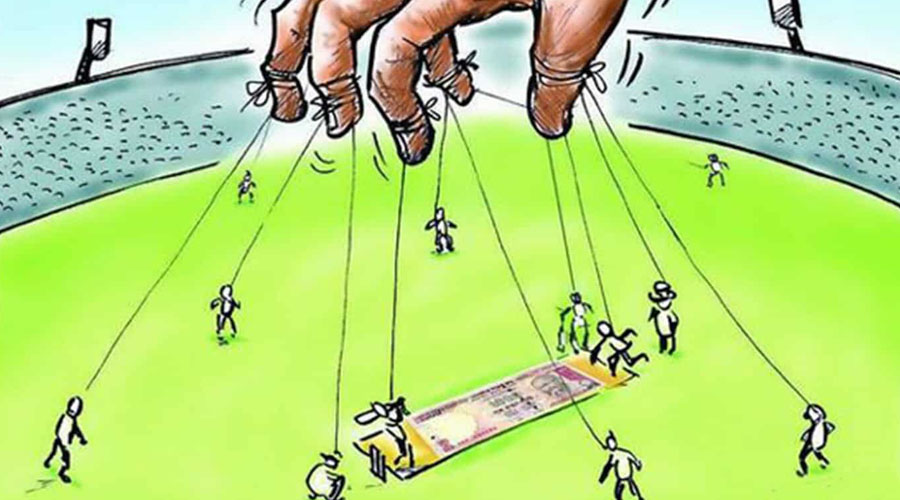
Comment (6)