Par Anouar Macta – Le Sahara Occidental est devenu la scène d’un paradoxe cinglant. Le Maroc et ses alliés s’acharnent à exploiter un territoire qu’ils prétendent maîtriser, mais dont les richesses les minent plus sûrement qu’elles ne les renforcent. Le pillage systémique du phosphate, des ressources halieutiques et désormais des gisements énergétiques offshore n’est pas seulement une violation du droit international, mais un mécanisme d’autodestruction lente, maquillé en réussite économique.
Ces ressources ne profitent jamais à ceux qui y vivent, mais servent à irriguer un appareil monarchique qui se maintient, non par mérite ni par légitimité politique, mais par distribution de rentes, achats d’alliances et étouffement social. La rente sahraouie n’est pas un moteur de modernisation ; c’est un sérum de survie injecté à un système qui refuse de regarder en face ses propres faiblesses structurelles.
On voudrait faire croire que le «modèle marocain» séduit, attire, aspire. Pourtant, les Sahraouis n’en veulent pas. Et ce rejet, persistant, massif, inentamé, n’est pas l’œuvre d’un «intrus extérieur». Il procède d’une évidence : personne ne souhaite rallier un royaume où la citoyenneté se confond avec l’obéissance aveugle, où l’administration sert de bras armé à un pouvoir opaque, et où la dignité individuelle se négocie au guichet d’un Makhzen tentaculaire.
Un Etat qui peine à nourrir sa propre population prétend transformer, élever ou intégrer un peuple qu’il considère d’abord comme une source de revenus, mais le récit officiel se fissure dès que l’on touche au réel. Dans les provinces marocaines périphériques, la pauvreté s’étend, les infrastructures manquent, et l’Etat recule. Comment un tel système pourrait-il prospérer au Sahara Occidental autrement qu’en serrant encore davantage le cou d’un peuple déjà révolté par l’humiliation quotidienne ?
La complicité occidentale est, elle aussi, d’une clarté embarrassante. Les capitales qui donnent des leçons de démocratie et de droit humain ne s’embarrassent plus d’élans moraux lorsqu’une cargaison de phosphate, un permis d’exploration ou un contrat d’énergie verte se présentent. L’indignation humaniste disparaît toujours dans le bruit du tiroir-caisse.
Ce qui dérange, dans la position constante algérienne, n’est pas un prétendu «rôle caché». C’est la capacité d’Alger à exposer, sans fioritures, la mécanique coloniale réinventée, celle d’un pillage local adoubé par des parrains extérieurs, qui proclament des principes le matin et signent des contrats le soir. L’Algérie agit comme un miroir brut, renvoyant aux puissances leur propre duplicité, leur confort moral de façade, leur désinvolture envers les peuples qu’elles sacrifient aux intérêts du moment.
La monarchie marocaine, en s’accrochant à des ressources volées pour maintenir son édifice, a fait du Sahara Occidental son talon d’Achille. Les richesses du désert ne stabilisent pas le système, elles l’enchaînent à ses pires défauts. Chaque tonne extraite, chaque accord signé, chaque poisson vendu renforce l’illusion d’un pouvoir solidifié, alors qu’il ne fait que prolonger une fuite en avant.
Le butin sahraoui n’enrichit pas le Maroc. Il l’empoisonne. Et c’est au rythme de cette intoxication politique, économique et morale que s’écrit, sans bruit mais sûrement, l’érosion d’un système qui croyait pouvoir bâtir son avenir sur un territoire qu’il ne possède pas et un peuple sahraoui digne qui ne se soumettra jamais.
A. M.


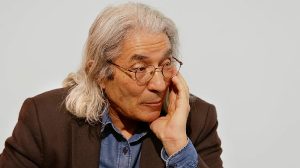



« Ces ressources ne profitent jamais à ceux qui y vivent, mais servent à irriguer un appareil monarchique qui se maintient, non par mérite ni par légitimité politique, mais par distribution de rentes, achats d’alliances et étouffement social. » souligne A. M..
A moins de croire en l’existence d’un monde des Bisounours où tout le monde cherche le bonheur de ……………… tout le monde, il n’y a absolument rien d’étonnant à ce que, dans un système*, i. e. le système du makhzen, basé sur l’asservissement et l’exploitation des individus lambda, les « ressources ne profitent jamais à ceux qui y vivent, mais servent à irriguer un appareil monarchique qui se maintient, non par mérite ni par légitimité politique, mais par distribution de rentes, achats d’alliances et étouffement social. »
En termes crus, l’analyse concrète de la situation concrète montre que le makhzen essaie de se reproduire en tant que tel en s’alliant à des puissances étrangères qui ont intérêt à la pérennisation du système makhzenien.
moralité de l’histoire: il n’y en a aucune, à part que le butin sahraoui, contrairement à ce qu’avance A. M., enrichit**, à cours et à moyen terme, le makhzen, quant au long terme, nous serons tous morts comme le dirait J. M. Keynes.
Wa el fahem yefhem.
* On pourrait en dire autant du système capitaliste, en général.
** Voir les investissements effectifs opérés par les multinationles au Sahara Occidental qui montrent que le « butin » sahraoui est considéré comme une ………….. affaire ………….. juteuse.
je crois que ce qui est pire ce n est pas le peuple marocain qui profite de ce qui est mal acquis
Le pillage des ressources du Sahara Occidental qui sert à maintenir en place un système monarchique arrivé à bout de souffle. La complicité occidentale qui ne fait que démontrer l’hypocrisie de leur modèle démocratique. Ce ne sont pas les valeurs humaines qui les intéressent mais le profit. Les ressources volées sont bien un « butin empoisonné ». Rien de noble dans tout ça.
Free Western Sahara. 🇪🇭
« Bien mal acquis ne profite jamais, seule une conduite juste préserve de la mort ».
On a dit au Sultan Alaouite de Fès
– “Tu seras un roi”
– on te donnera un pays qu’on appellera “royaume” de “maroc”
– Pour “unir” les tribus ton nouveau royaume On t’inventera une Histoire de 600 ans et on t’inventera une Culture ect…
..
Nous soumettrons les tribus rebelles du “Bled el Siba “ du Rif
Nous soumettrons le Sultan de Marrakech
L’Empire Français t’offrira sa Protection
.
Mais Attention ⚠️
En Échange
Tu serviras ton créateur la France 🇫🇷 pour toujours
Tu partageras les richesses de “Maroc” avec nous
Tu obéiras
….
Le problème c’est que les LÉGENDES s’EFFONDRENT un peu plus a chaque Tremblement de Terre.
…
Malgré le bénéfice des Trahisons et des Soumissions
En 1972 et 1973
le Sultan est menacé par des Coups d’Etat
1975 :
Le Sahara Occidental , 🇪🇭 devient l’Unique porte de Sortie pour Survie du Régime
.
C’est un ÉCHEC
Les Fantasmes se sont Fracasse contre Le Mur du Peuple Saharaoui
.
Une impasse
L’Histoire retiendra que L’Occupation MILITAIRE du SAHARA OCCIDENTAL sera le Dernier ACTE DÉSESPÈRE et SUICIDAIRE d’une vaste Supercherie Coloniale.
On ne colonise jamais un pays pauvre sans intérêt géopolitique et géostratégique.
FREE WESTERN SAHARA
FREE NAÂMA ASFARI
FREE PALESTINE