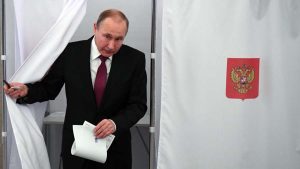Par R. Mahmoudi – A quelques semaines du sommet des chefs d’Etat du Maghreb et du Moyen-Orient, prévu comme par hasard en Arabie Saoudite, l’événement ne suscite aucune curiosité, aucun intérêt. Alors que d’habitude, tous les pays de la région exprimaient des attentes et les débats foisonnaient dans la presse sur les perspectives à entrevoir pour les grandes questions de l’heure.
C’est un signe que la Ligue arabe ne représente plus rien, y compris pour ceux qui l’ont monopolisée depuis quelques années, c’est-à-dire pour les Al-Saoud et leurs alliés émiratis et égyptiens. Après avoir torpillé littéralement le Conseil de coopération du Golfe (CCG), suite à la mise à l’écart de leur petit protégé encombrant, les Al-Saoud s’attellent depuis la dernière réunion des ministres arabes des Affaires étrangères au Caire, à rendre totalement inopérante «l’action arabe commune» chère aux pères fondateurs de la Ligue. Parce que, à ce rythme, il n’y restera plus aucun pays et cela fait longtemps déjà que la plupart des pays membres, dont l’Algérie, assistent aux réunions de cette organisation sans conviction et sans enthousiasme.
Cela dit, est-ce une bonne chose que la Ligue arabe disparaisse dans la conjoncture actuelle ? Pas si sûr. Car cela ne peut qu’aggraver une ligne de fractures déjà béante entre tous les pays qui la composent et, dans le même temps, faciliter la tâche aux différents prédateurs néocolonialistes qui guettent l’effritement de cette région si vaste et si riche en ressources naturelles pour se la partager, comme au moment de la chute de l’empire ottoman.
Ce qu’il faudra, peut-être, à la place de cette structure obsolète, c’est d’imaginer une autre forme d’union, avec des acteurs nouveaux et une idéologie saine. Mais, pour y parvenir, il faudra au préalable construire un nouveau rapport de forces. Cela peut paraître comme une utopie, mais toutes les grandes idées ont commencé comme cela.
R. M.